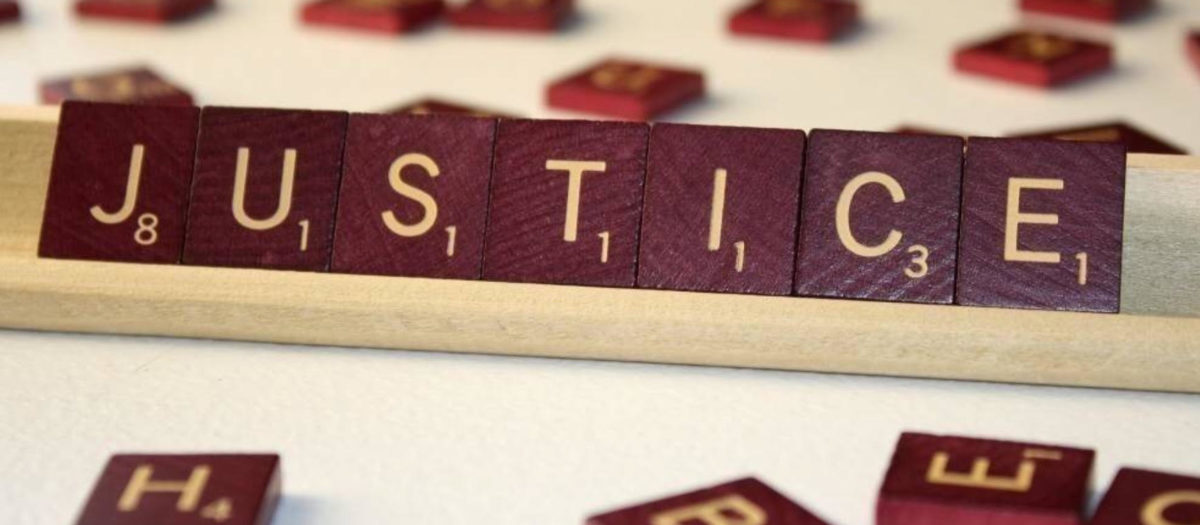Le travail donne parfois lieu à des relations conflictuelles, perçues à tort ou à raison comme du harcèlement moral.
Le Code du travail donne précisément la définition du harcèlement moral. Il est constitué par trois conditions cumulatives :
- des agissements répétés,
- dégradant les conditions de travail (matérielles, humaines ou relationnelles),
- et affectant la santé de la victime et son avenir professionnel.
Il se distingue donc du simple conflit et implique de la part de l’auteur une intention de nuire. La preuve du harcèlement moral est généralement difficile à rapporter, notamment le caractère répété des agissements en l’absence de témoins ou si les autres membres du personnel répugnent à attester. La preuve du lien de causalité entre les comportements reprochés et les répercussions néfastes sur les conditions de travail et la santé du salarié pose aussi une difficulté. En effet, le médecin traitant comme le médecin du travail ne peuvent que relater les griefs du salarié sans possibilité d’établir avec certitude le lien avec des faits intervenus pendant le travail, dont ils n’ont pas eux-mêmes été témoins.
La solution du procès apparaît donc assez aléatoire et peu adaptée vu la lenteur judiciaire. Il est en effet à craindre que le climat délétère perdure tant que l’affaire n’a pas été jugée et l’auteur des faits sanctionné.
Deux autres alternatives s’offrent alors à la victime. La première est de signaler le plus vite les faits à sa hiérarchie. L’employeur étant responsable de la santé physique et psychique de ses salariés, il a l’obligation de prendre toutes les dispositions nécessaires pour prévenir le harcèlement moral ou sexuel. Il lui incombe en particulier de procéder à une enquête et à des investigations pour établir les faits et prendre les mesures appropriées. Le Code du travail ne précise pas la manière dont ces investigations doivent être menées. L’article L 1154-1 impose seulement au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et à l’autre partie, au vu de ces éléments, de prouver que les agissements visés ne sont pas constitutifs de harcèlement et justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de nuire.
La seconde solution est de faire une demande de médiation, au visa de l’article L1152-6 du Code du Travail. La jurisprudence considère en effet que l’employeur a le devoir de la mettre en œuvre si un salarié en fait la demande. L’employeur peut lui-même avoir intérêt à la proposer car elle permet une appréhension rapide, peu onéreuse, confidentielle et constructive du conflit.
Fondée sur leur volonté et leur coopération, la médiation a pour but d’amener les parties à trouver elles-mêmes la solution à leur litige avec l’aide d’un professionnel neutre et indépendant, spécialement formé à la médiation. C’est un procédé gagnant/gagnant puisque son taux de réussite est considérable (en moyenne supérieur à 70 %). Parmi ses nombreux avantages, la médiation est une solution contradictoire, respectueuse du ressenti et de la parole de chaque partie qui, avec l’aide du médiateur parviendra à dépassionner le conflit, pour déterminer de manière plus objective et pragmatique les solutions qui le régleront de manière définitive. Elle permet donc aux parties de se réapproprier la gestion de leur différend en trouvant elles-mêmes les solutions d’un accord durable. Elle aboutit parfois à des solutions ou alternatives originales qu’un juge ne pourrait pas ordonner. Elle présente un intérêt évident dans toutes les situations où les parties ont vocation à poursuivre leurs relations. La médiation est donc un mode de règlement amiable particulièrement adapté aux conflits du travail, à ne pas négliger.