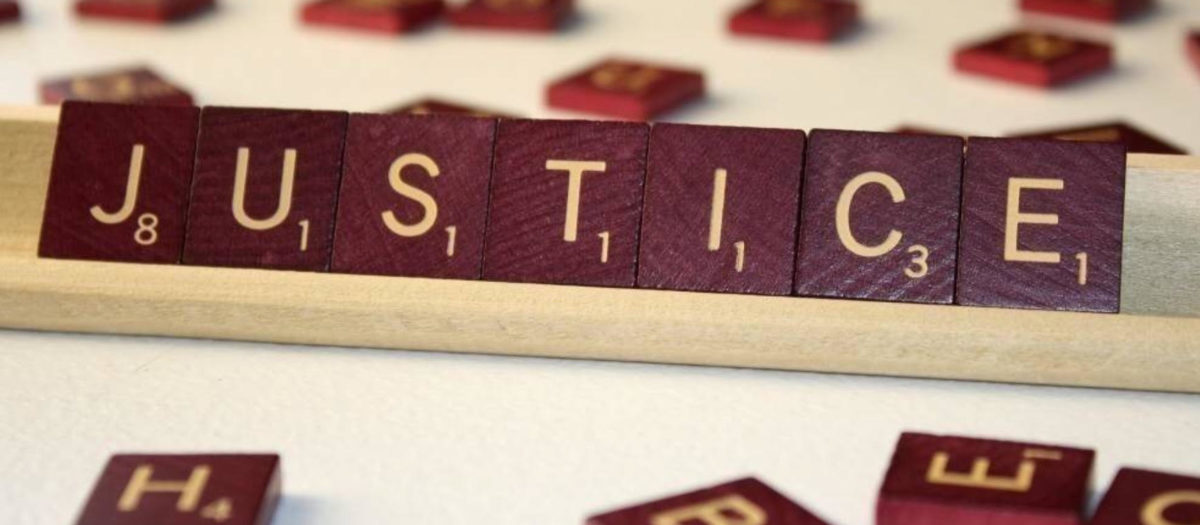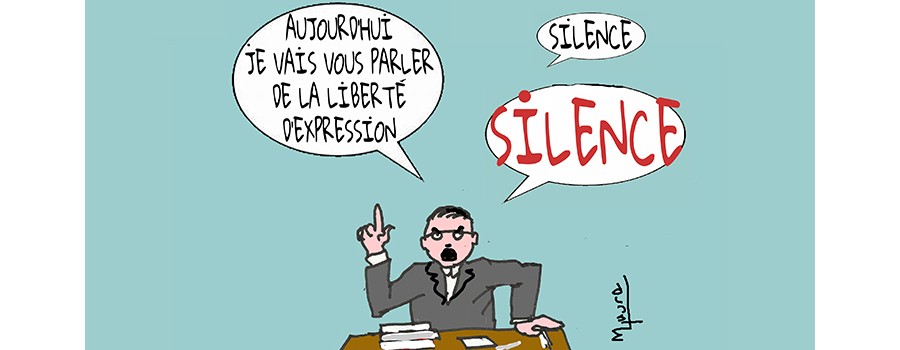Face à des remarques trop critiques du salarié ou une obstruction systématique, l’employeur peut être tenté de le licencier. Il devra alors être extrêmement prudent car si certains motifs constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, d’autres entraînent sa nullité ; ce qui peut alourdir sensiblement les indemnités qu’il serait condamné à lui payer.
L’employeur devra en particulier bien motiver la lettre de licenciement puisque c’est elle qui fixe le cadre du litige, et vérifier la qualification donnée aux faits. En effet, les risques ne sont pas les mêmes selon qu’il s’agit d’une insubordination caractérisée, d’une perte de confiance ou de propos certes désagréables ou pénibles mais parfaitement autorisés.
L’insubordination suppose des faits concrets manifestant le refus du salarié d’exécuter les missions qui lui sont confiées. Elle justifie le licenciement et peut même dans certains cas constituer une faute grave.
Tel n’est pas le cas de la perte de confiance, dont l’appréciation est nécessairement subjective si bien que de jurisprudence constante, elle « ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement, même quand elle repose sur des éléments objectifs. Seuls des éléments objectifs peuvent, le cas échéant, constituer une cause de licenciement, mais non la perte de confiance qui a pu en résulter pour l’employeur » (Cass. Soc 29 mai 2001, n° 98-46341).
Quant aux propos critiques du salarié, manifestant son désaccord ou son opposition, ils ne sauraient fonder un licenciement et peuvent entraîner sa nullité, pour violation d’une liberté fondamentale : la liberté d’expression du salarié dans l’entreprise.
L’article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales dispose en effet que toute personne a droit à la liberté d’expression.
Cette liberté a une valeur constitutionnelle puisqu’elle figure à l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et à l’article 5 du préambule de la Constitution de 1946. Elle consacre le droit fondamental de chacun de communiquer librement ses pensées et opinions, sans pouvoir être lésé dans son travail ou son emploi.
Selon l’article L 1121-1 du Code du travail : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature des tâches à accomplir ni proportionnées au but recherché. »
La jurisprudence réaffirme constamment que la violation de la liberté d’expression, droit fondamental du salarié dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, entraîne sauf abus, la nullité du licenciement.
Le salarié est d’autant mieux fondé à s’exprimer librement qu’il exerce des fonctions d’encadrement impliquant la responsabilité d’assurer la bonne marche du service, la cohésion, la stabilité des équipes et la satisfaction des clients.
L’expression d’opinions, de réserves, de craintes, de divergences de vue, de critiques ou de propositions fait naturellement partie de la liberté d’expression et ne peut donc être sanctionnée sauf abus.
Selon la Cour de cassation, l’abus ou le caractère disproportionné sont caractérisés par l’emploi de propos injurieux, diffamants ou excessifs.
Cette appréciation est stricte. C’est pourquoi il a été jugé que les propos suivants, tenus par le salarié, ne caractérisaient pas un abus mais un simple usage de sa liberté d’expression :
- « Un PDG en mode panique » ; « Une équipe de direction qui ne comprend plus son PDG » ; « Un PDG visiblement reparti sur une paranoïa aigüe (Cass. soc., 15 mai 2019, n° 17-20.615).
- « 4 ans de non-gestion où le groupe a renié des valeurs aussi essentielles que sécurité et éthique » ; « Le management mis en place avant mon arrivée est incompétent, gravement incompétent » ; « Personne n’est à la hauteur » (Cass. soc., 29 juin 2022, n° 20-16.060).
- La dénonciation de faits de harcèlement moral par le salarié, bien que les faits n’aient pas été qualifiés » (Cass. Soc., 19 avr. 2023, n°21-21.053).
- L’hostilité manifestée par le salarié à l’égard de la personne chargée de mettre en œuvre la réorganisation de l’agence dont il était responsable et sa désapprobation de la réorganisation (Cass. Soc., 14 févr. 2024, n°22-17.332).
Au visa de l’article L 1235-3-1 du Code du Travail, le salariévictime d’un licenciement nul qui ne demande pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part, aux indemnités de rupture et d’autre part, à une indemnité au moins égale aux six derniers mois de salaire.
Mais attention, seuls les propos émis personnellement par le salarié sont protégés par la liberté d’expression et non ceux tenus par son avocat, même s’ils reflétaient ses doléances. C’est ce que vient de préciser la Cour de Cassation dans un arrêt du 10 septembre 2025 concernant un courrier adressé par l’avocat du salarié à l’employeur (Cass. Soc., n°24-12595 FSB).
Caroline Pons-Dinneweth